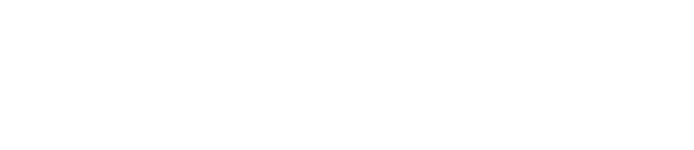Le Parlement britannique rejetait, jeudi 29 août 2013, l’idée d’une intervention militaire contre la Syrie. Si David Cameron n’était pas tenu de respecter la volonté du Parlement, il avait annoncé au préalable qu’il suivrait la décision des membres des Communes et il a tenu parole après le vote. Mais comment la décision d’une intervention militaire est-elle prise dans les principales démocraties occidentales, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en France ?
[image:1,l]
En France comme en Grande-Bretagne, la consultation du Parlement avant une intervention militaire n’est absolument pas obligatoire. Si la Chambre des Communes britannique a rejeté jeudi soir, par 285 voix contre 272, une motion présentée par le Premier ministre britannique, qui défendait le principe d’une intervention militaire en Syrie, David Cameron a immédiatement indiqué qu’il tirerait les conséquences de ce vote : « Il est clair que le Parlement britannique ne veut pas d’intervention militaire britannique. Je prends note et le gouvernement agira en conséquence ».
Au Royaume-Uni, l’avis du parlement demandé et respecté
Le monarque britannique, actuellement la reine Élisabeth II est nommé commandant en chef des forces armées. Cependant, la reine cède ce pouvoir militaire au Premier ministre et à son Cabinet, mais reste l’ « autorité suprême » militaire et conserve de pouvoir de prévenir son utilisation inconstitutionnelle. C’est donc au Premier ministre britannique que revient la décision d’une intervention militaire.
Il y a dix ans, le Royaume-Uni s’engageait au côté des États-Unis dans la guerre controversée en Irak. A l’époque, la décision de l’engagement britannique aux côtés des Américains avait été prise par Tony Blair avec consultation du Parlement. Après un débat houleux de deux jours, une large majorité des députés avait voté pour la guerre. Ce vote n’a qu’une valeur consultative, mais les premiers ministres britanniques ont pris l’habitude de respecter les votes de la Chambre des Communes, avant ce genre de décisions.
« Je continue de croire qu’il fallait déposer Saddam », estimait récemment l’ancien Premier ministre, dans une interview accordée à la télévision britannique ITV. « J’ai pris une décision que je croyais juste. Et je l’ai prise sciemment en sachant qu’elle serait très impopulaire ». Cette fois-ci le Parlement a préféré la vigilance à l’alignement.<!–jolstore–>
En France, la décision revient au président de la République, chef des armées
En France, c’est l’article 35 de la Constitution qui définit les modalités démocratiques d’une intervention armée : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »
L’autorisation du Parlement n’est demandée que pour un conflit de plus de quatre mois : « Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.»
François Hollande a choisi de consulter le Parlement le 4 septembre, au sujet de l’intervention en Syrie. Ce vote n’ayant qu’une valeur consultative, un refus des députés n’empêcherait pas le chef de l’Etat d’intervenir malgré tout.
Aux Etats-Unis, le Congrès est consulté au bout de soixante jours
Aux Etats-Unis, le War Powers Resolution de 1973 autorise le Président américain à engager les troupes pendant soixante jours. Au-delà de ces soixante jours, il lui faut l’autorisation du Congrès. Dans les faits, la Constitution américaine donne au Congrès le pouvoir de « déclarer la guerre », ce qui n’est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis, les présidents américains décident des interventions extérieures, au nom de leur autorité constitutionnelle de commandant en chef.
Si le War Powers Resolution est rarement respecté par l’exécutif américain, il est encore plus rare de voir un président demander l’avis du Congrès pour intervention aussi ponctuelle que celle que projettent de lancer les Américains et les Français. « Même si j’ai le pouvoir de lancer cette action militaire sans autorisation spécifique du Congrès, je sais que notre pays sera plus fort si nous suivons cette voie et que nos actes seront ainsi plus efficaces », a déclaré samedi dernier Barack Obama. Faut-il y voir une forme de renoncement ? La communauté internationale s’interroge.